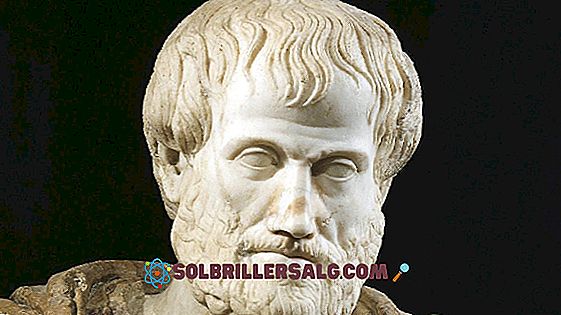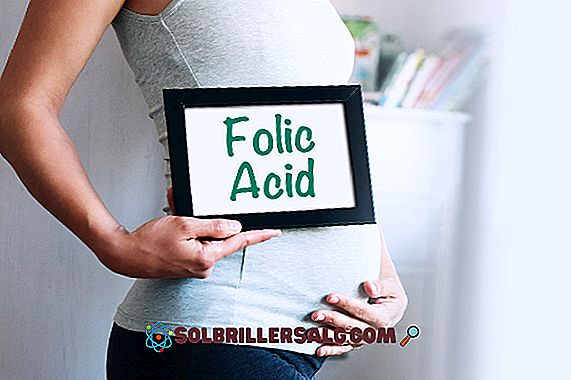Expropriation de pétrole au Mexique: contexte, causes, historique et conséquences
L' expropriation du pétrole au Mexique a consisté en la nationalisation de l'industrie pétrolière basée dans le pays. Il s'est déroulé en 1938 sous la présidence de Lázaro Cárdenas. La législation appliquée à ce processus était la loi sur l'expropriation de 1936 et l'article 27 de la Constitution mexicaine.
Depuis la découverte du premier puits de pétrole dans le pays, l’exploitation de cette précieuse ressource était entre des mains privées. Au cours du Porfiriato, les dépôts ont été transférés à des sociétés étrangères, principalement américaines.

Le triomphe de la révolution mexicaine a marqué le début du changement de la politique pétrolière du pays. La Constitution de 1917 incluait un article, le 27, qui déclarait que le sous-sol mexicain et ses richesses étaient des biens nationaux. Malgré cela, aucune action en justice n'a été intentée.
Dans les années 1930, les mauvaises conditions de travail des travailleurs ont entraîné la création d'un syndicat. Ses actions ont eu le soutien du président Cárdenas. L'absence d'accord et la prétention selon laquelle l'État tirait des bénéfices de cette ressource énergétique ont amené le gouvernement à nationaliser le secteur par un décret.
Antécédents
Le premier puits de pétrole en surface a été foré en 1862 dans l’état de Tabasco. Le Mexique était gouverné par l'empereur Maximilian, qui avait promulgué un décret autorisant l'exploitation de cette ressource, à condition que le gouvernement l'autorise. Avec cette législation, 38 concessions pétrolières ont été accordées à des particuliers.
Le porfiriato
Après 1886, sous la présidence de Porfirio Diaz, les premières entreprises américaines ont commencé à arriver au Mexique pour reprendre les dépôts. Cette année-là, les premières raffineries sont inaugurées à Veracruz: El Águila et la Water Pierce Oil Company, toutes deux à la capitale des États-Unis.
En 1890, la compagnie pétrolière mexicaine de Californie fut créée à San Luis Potosí et en 1896, le groupe Sinclair s'installa près de la ville de Tampico. En peu de temps, les exploitations se sont multipliées.
La compétition pour obtenir des concessions a été très difficile et c'est El Águila qui l'a gagnée. En 1910, cette société gérait 50% du marché. Huit ans plus tard, la plupart de ses actions ont été reprises par Royal Dutch Shell.
Politique fiscale pendant le porfiriato
La politique économique du Porfiriato a tenté d'attirer des investisseurs étrangers dans le pays. Ainsi, il a favorisé son contrôle des mines et des champs de pétrole, ce qui a été répudié par les dirigeants de la révolution mexicaine.
Parmi les mesures prises par le gouvernement de Porfirio Díaz figurait la loi sur le pétrole, promulguée en 1910. Cette loi établissait une série de privilèges pour les sociétés pétrolières étrangères, notamment le fait de ne pas avoir à payer de taxes à l'exportation sur le matériel nécessaire à l'exploitation des gisements.
De même, le capital investi était libre de tout privilège fiscal au cours des dix années suivantes. Enfin, l’achat de terres nationales au prix des terrains vacants était libre.
Cette loi indiquait également que les sociétés pourraient procéder à des explorations et exploiter le pétrole trouvé en échange du versement de 7% des bénéfices au gouvernement central, ainsi que de 3% supplémentaires au gouvernement de l'État dans lequel les puits étaient situés.
Révolution méxicaine
La révolution mexicaine de 1910 a entraîné un changement de politique pétrolière. Francisco Madero, premier président après la première phase de la révolution, a lancé un processus de régulation de l'activité. Son renversement par le coup d'État de Victoriano Huerta ne lui permit pas de renforcer sa politique.
Pendant le bref gouvernement de Huerta, les Américains sont intervenus pour que leurs sociétés pétrolières ne paient pas les taxes annoncées par Madero.
La deuxième phase de la Révolution s'est terminée avec le régime de Huerta, remplacé par Venustiano Carranza. La politique de réglementation de Madero a été rétablie et, déjà dans son Plan de Guadalupe, il était nécessaire de promulguer une législation nationaliste sur le pétrole.
En 1915, la Commission technique du pétrole a commencé à fonctionner, chargée d'organiser l'industrie dans le pays. La première étape a été de rétablir les relations avec les entreprises présentes sur le territoire mexicain.
Un an plus tard, en avril 1916, la Commission publia un rapport dans lequel elle affirmait la nécessité de fixer la richesse du sous-sol au domaine du pays. Ainsi, la nouvelle Constitution, promulguée en 1917, a établi le droit de propriété nationale sur le sol et le sous-sol liés au pétrole.
Premiers affrontements
Bien que figurant dans la Constitution, la loi qui devait mettre en œuvre cet article a pris des années à être rédigée. Les gouvernements de Carranza, de la Huerta et d'Obregón ont dû faire face à la résistance des compagnies pétrolières et aux pressions des États-Unis.
En 1923, le gouvernement d'Álvaro Obregón et les représentants américains ont signé les accords de Bucareli. Celles-ci étaient axées sur l'application rétroactive de la loi sur les mines et le pétrole, ainsi que sur les taxes appliquées aux sociétés américaines. Obregon a été contraint de réduire le fardeau fiscal et de différer la loi nationaliste.
Le successeur d'Obregón, Plutarco Elías Calles, a décidé de ne plus exercer de pression. Ainsi, il a accéléré la promulgation de la loi réglementaire de l'article 27 de la Constitution. Le Congrès l'a approuvé en novembre 1925.
Selon cette loi, les compagnies pétrolières étaient obligées de renouveler et de confirmer leurs concessions, de payer plus d'impôts et de se conformer aux normes juridiques mexicaines. Les sociétés ont porté plainte contre le gouvernement, une situation qui a perduré jusqu'à l'arrivée de Lázaro Cárdenas à la présidence.
Les causes
Les principales causes de l'expropriation de l'industrie pétrolière étaient, fondamentalement, le désir du Mexique de tirer parti de sa richesse naturelle et, d'autre part, des mauvaises conditions de travail des travailleurs dans les gisements.
Revendications syndicales
Les revendications des travailleurs avaient déjà commencé au milieu des années 1920. Les compagnies pétrolières ont réussi à empêcher les syndicats de se former pendant dix ans, mais le 27 septembre 1935, la première est apparue: le Syndicat des travailleurs du pétrole de la République mexicaine (STPRM). ).
Ce syndicat deviendrait bientôt l'un des dominants de la Confédération des travailleurs du Mexique, pour lequel il reconnaissait le droit de grève de ses membres.
À cette époque, les travailleurs mexicains faisaient beaucoup moins payer que les étrangers. Cette situation a alimenté de nombreux conflits de travail. Les grèves ont rapidement commencé à être appelées, interrompant la production de temps en temps.
Ressources propres qui n'ont pas profité au pays
La demande de main-d’œuvre au Mexique n’est pas la seule cause de la gêne ressentie par les sociétés pétrolières étrangères. Dans le pays, on était convaincu depuis plusieurs décennies que les bénéfices tirés de ses ressources n’avaient aucun effet sur leur propre bien-être.
Les sociétés pétrolières étrangères réalisaient des profits énormes avec le pétrole mexicain, sans que cela ait un impact sur l'amélioration des conditions de vie de la population.
Cárdenas a entamé une série de réunions avec des représentants des sociétés pour tenter de trouver une solution négociée. Cependant, les réunions se sont terminées sans aucun accord.
Réforme de l'article 27 de la Constitution
Bien que Cárdenas ait pu éventuellement trouver un moyen de rendre l’exploitation exploitable, il ne fait aucun doute que l’article 27 de la Constitution de 1917 permettait de le faire plus facilement.
Déjà en 1914, Luis Cabrera avait proposé que l'État tire davantage parti de l'exploitation du pétrole. À partir de ce moment, le gouvernement a commencé à mettre en pratique des mesures revendiquant la propriété de l’État sur les richesses du sous-sol.
Lors de la réunion du congrès constitutif, un consensus clair existait déjà pour établir une distinction légale entre la propriété foncière et la propriété du sous-sol. Le résultat fut l'article 27, qui indiquait que si le premier pouvait appartenir à un particulier, le second, avec sa richesse, appartenait à la nation.
Histoire
La tension à l'intérieur des champs de pétrole a commencé avant les années 1930. En 1924, les travailleurs avaient déjà organisé des grèves, qui ont été violemment réprimées par les forces de sécurité de l'État.
Cependant, la même année, une grève est déclenchée à Tampico contre la raffinerie d'El Aguila, ce qui oblige l'entreprise à reconnaître le syndicat et à signer un accord de négociation collective.
Une décennie plus tard, en 1935, le Syndicat des travailleurs du secteur pétrolier de la République mexicaine était fondé. Une de ses premières mesures consista à écrire un projet dans lequel la journée de travail de 40 heures était réclamée, en plus du paiement de la totalité du salaire en cas de maladie.
En 1937, les travailleurs ont commencé à faire pression sur les entreprises pour qu'elles signent le projet. Le refus de ceux-ci a amené le syndicat à les poursuivre devant le Conseil général de conciliation et d'arbitrage. De plus, le 31 mai, une grève a commencé jusqu'au 9 juin.
Commission d'experts
Les sociétés pétrolières ont prétexté qu'elles ne disposaient pas de ressources suffisantes pour répondre à la demande des travailleurs. Cependant, une étude réalisée par une commission d’experts a démenti cette affirmation, affirmant que ses avantages étaient bien supérieurs à ceux annoncés.
Les entreprises ont accepté ce rapport avec rejet. Le 18 décembre, ils ont dû comparaître devant le conseil de conciliation qui les a condamnés à payer 26 millions de pesos pour la retenue de leurs salaires lors de la grève de mai.
Droit constitutionnel d'exproprier
En 1936, le gouvernement avait promulgué une loi réglementant les expropriations de sociétés et de propriétés pour des raisons d'utilité publique.
Sa première utilisation remonte à juin 1937, lorsque l’État expropria les chemins de fer nationaux du Mexique. Avec cela, il a résolu la grève des travailleurs de ce secteur. Ce contexte était fondamental pour ce qui s’est passé avec l’industrie pétrolière.
Dernières tentatives de rapprochement
Le 18 mars 1938 a été le jour clé de l'histoire de l'expropriation du pétrole. Dans la matinée, la décision du Bureau central de conciliation et d'arbitrage était connue, ce qui annulait le contrat collectif entre les sociétés et le syndicat du pétrole.
Les représentants des entreprises se sont rapidement rendus à Cárdenas. Face à la décision prise à leur encontre, ils ont promis d'augmenter les salaires des travailleurs, mais le président les a avertis qu'il était trop tard.
Selon les historiens, la décision avait été prise pratiquement une semaine auparavant. Les entreprises ont menacé l’Etat de retirer tous ses investissements et de quitter le pays, sous la protection de leurs gouvernements respectifs.
L'expropriation
Le décret d'expropriation a été présenté le même 18 mars à dix heures du soir. Par son intermédiaire, Lázaro Cárdenas, avec le soutien du Congrès, a ordonné l'expropriation de tous les biens et propriétés immobiliers des 17 sociétés pétrolières américaines et britanniques opérant sur le sol mexicain. Les concessions précédentes ont été annulées.
Le lendemain matin, les travailleurs ont pris possession des entreprises touchées. Le gouvernement a publié un autre décret visant à créer un conseil d'administration du pétrole chargé de coordonner l'administration temporaire des biens et des activités.
Conséquences
Les réactions au décret d'expropriation n'ont pas attendu. Le Royaume-Uni a rompu ses relations diplomatiques et les États-Unis et les Pays-Bas ont décrété un embargo sur le commerce, en plus du retrait de tout le personnel technique.
Par ailleurs, les Américains ont cessé d'acheter du pétrole et de l'argent mexicains, privilégiant l'or noir du Venezuela.
Soutien populaire
En revanche, à l’intérieur du pays, le soutien populaire à la mesure a été spectaculaire. Le 23 mars, une manifestation spontanée de soutien a éclaté, à laquelle ont assisté plus de cent mille personnes. Le 19 avril, une autre marche a été organisée, celle-ci étant réalisée par des femmes.
La population a commencé à donner de l'argent pour payer les indemnités prévues pour l'expropriation. L'effort était remarquable, même s'ils ne pouvaient lever que 2 millions de pesos. L'émission d'obligations ne pouvait pas couvrir le montant à payer, même si elle montrait la popularité de la mesure.
Même des secteurs opposés à Cárdenas, tels que l'Église catholique et les hommes d'affaires conservateurs, ont manifesté leur soutien à la décision du gouvernement.
Création de PEMEX
Lorsque des techniciens et des ingénieurs étrangers ont quitté le Mexique, le gouvernement a dû reprendre les fermes. L'administration générale du pétrole (AGPN) a été la première agence à prendre la relève.
Un mois plus tard, la Distribuidora de Petróleos Mexicanos était créée pour contrôler la commercialisation du pétrole. Le 7 juin, un décret est entré en vigueur, lequel est entré en vigueur le 20 juillet, par lequel la Société des pétroles mexicains (PEMEX) a été créée, afin de se charger de l’exploration, de la production et du raffinage pétroliers.
Boycott contre le Mexique
Les gouvernements étrangers n'ont pas seulement réagi contre le Mexique. Standard Oil et Royal Dutch Shell ont lancé une campagne de boycott contre le pays, tentant de l'empêcher d'acheter certains produits chimiques essentiels au raffinage du pétrole.
Un de ces produits était le plomb tétraéthyle. Le Mexique a résolu le problème en réformant l’essence. Un peu plus tard, des étudiants en chimie de l'Institut national polytechnique et de l'Université nationale autonome ont réussi à synthétiser le produit.
Avec le temps, le boycott perdait de sa vigueur et le Mexique pouvait acheter des machines à l'Allemagne, à l'Italie et à d'autres pays européens.
Compensation aux compagnies pétrolières
À la fin de 1939, le gouvernement s'entretient avec les Américains pour négocier le versement d'une indemnité. Les premiers chiffres que les entreprises ont mis sur la table étaient inacceptables pour le Mexique, puisqu'ils avoisinaient les 32 millions de dollars.
Au cours des mois suivants, les conversations se sont poursuivies. Peu à peu, les prétentions des entreprises expropriées ont été réduites pour rester à 14 millions de dollars.
Finalement, l'accord a été conclu le 1er mai 1940. Les Américains ont accepté de recevoir 8, 5 millions d'euros, qui seraient versés dans un délai de trois ans. En outre, ils recevraient 20 millions de barils à un prix inférieur au prix du marché.
Seconde Guerre mondiale
Les historiens s'accordent à dire que sans la pression de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'auraient pas permis l'expropriation. Avec la guerre en vue, le président Roosevelt a préféré maintenir une alliance avec le Mexique.
Pendant un certain temps, le boycott a incité les seuls acheteurs de pétroliers mexicains à être le Japon et l’Allemagne, jusqu’en 1937. Toutefois, les alliés ont levé l’embargo en 1941, en partie grâce aux bonnes relations entre Cardenas et Roosevelt.
Le pétrole était également la raison de l'entrée du Mexique dans la Seconde Guerre mondiale. Cela s'est produit lorsque deux de leurs pétroliers ont été coulés par des sous-marins allemands.