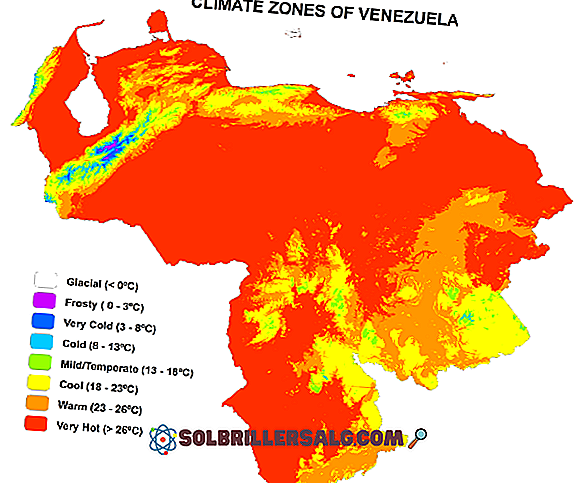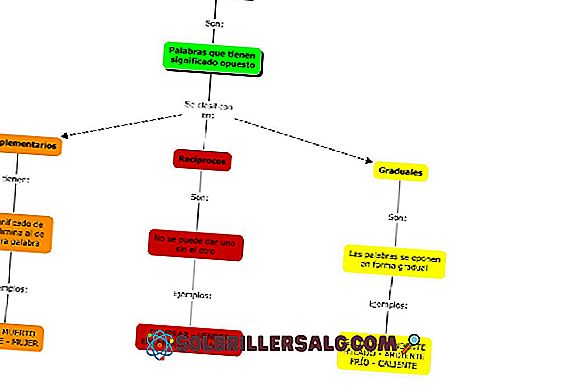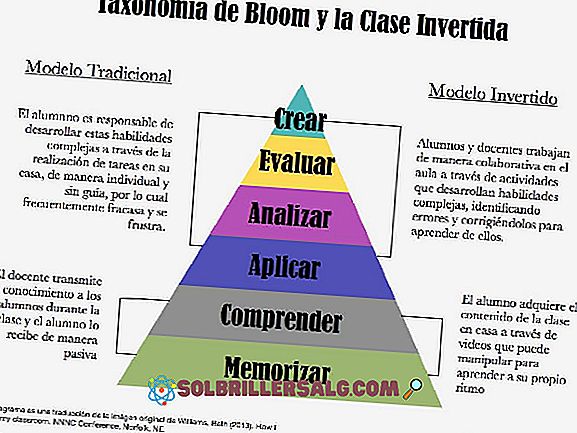Troubles de la conscience: causes et traitements
Le terme « trouble de la conscience» désigne à la fois une altération du niveau de conscience (obtentation, stupeur, coma, etc.) et une altération du contenu de la conscience (désorientation temporaire ou spatiale, ou difficulté à maintenir l’attention).
En chiffres, entre 30% et 40% des personnes souffrant de lésions cérébrales graves présentent des troubles de la conscience. Les causes de ces altérations peuvent être diverses et provenir de lésions focales ou diffuses, spécifiquement dans le tronc cérébral ou dans des structures apparentées, telles que le thalamus et le cortex d'association (Más-Sesé et al., 2015).

Les études les plus récentes montrent qu'il existe une augmentation significative du nombre de patients atteints de ce type d'affection après des lésions vasculaires. Cela est dû à la réduction drastique du nombre d'accidents de la route ayant subi de graves blessures à la tête.
En général, les chiffres ont tendance à varier entre les études, avec 44% des cas d'origine vasculaire et 72% des cas d'origine traumatique (Más-Sesé et al., 2015).
La souffrance de ce type de modifications représente une urgence médicale grave. Un diagnostic et un traitement corrects sont essentiels pour les empêcher de déclencher des blessures irréversibles ou même la mort de la personne (Puerto-Gala et al., 2012)
Conscience
Le terme conscience est défini comme l'état dans lequel un individu a la connaissance de lui-même et de son environnement (Puerto-Gala et al., 2012). Cependant, dans la conscience, les termes d'éveil et de conscience sont essentiels dans leur définition.
- Éveil : fait référence au niveau d'alerte comme "être conscient" et est responsable du maintien de la capacité à rester éveillé et à réguler le rythme veille-sommeil (Más-Sesé et al., 2015).
- Sensibilisation : désigne le niveau d'alerte comme "l'être conscient" et désigne la capacité que nous avons de détecter les stimuli de l'environnement et d'en prendre conscience, ainsi que de nous-mêmes (Más-Sesé et al., 2015).
Lorsque nous nous référons à l'altération de la conscience, nous pouvons nous référer à la fois au niveau d'activation ou de surveillance ainsi qu'à la capacité de celle-ci à interagir avec le détenu.
Par conséquent, un individu peut présenter une altération de niveau et un état d'obnundation, de stupeur ou de coma, ou une altération de contenu présentant une désorientation, avec ou sans idées délirantes (De Castro, 2008).
Jusqu'au milieu du XXe siècle environ, aucune modification précise n'a été trouvée concernant les altérations de la conscience au-delà des premières descriptions de Ronsenblath en 1899. C'est dans les années 1940 que plusieurs troncs de cerveaux commencent à apparaître (Más-Sesé et al., 2015). .
Ainsi, le rôle du SRAA (système de grille d’activation ascendant) dans la régulation des niveaux d’alerte a été mis en évidence. La capacité de rester éveillé dépendra du bon fonctionnement des structures qui composent ce système (De Castro, 2008).
La capacité des êtres humains à penser, à percevoir et à répondre aux stimuli est due au fonctionnement du cortex cérébral. Cependant, cela ne montrera pas une exécution efficace si la participation d'autres structures et sans le maintien d'un état de alerte adéquate. Lorsque nous dormons, il est nécessaire que le SRAA active le cortex pour nous réveiller (Hodelín-Tablada, 2002).
Toute blessure dans les structures qui la composent supposera une diminution ou une perte du niveau de conscience (Castro, 2008). La conscience est impossible si la SRRA est gravement blessée ou endommagée (Hodelín-Tablada, 2002).
États de diminution de la conscience
L'absence de réponse n'est pas toujours comparable à une perte totale de conscience. Par exemple, les bébés atteints de botulisme ne réagissent à aucun type de stimulation, mais sont néanmoins en alerte (Puerto-Gala et al., 2012).
Par conséquent, la conscience ou le niveau d'activation peut être représenté sur un continuum, d'un état modéré à un état grave d'absence totale de réponse. Ainsi, nous pouvons distinguer les états intermédiaires entre l'état de veille (alerte) et l'état d'absence totale de réponse (coma) (Puerto-Gala et al., 2012).
- Confusion : l'individu n'est pas capable de penser clairement et rapidement. Il répond à de simples commandes verbales, mais montre des difficultés avec des commandes complexes.
- Somnolence : le patient est endormi, mais peut être réveillé sans difficulté devant des stimuli sensoriels ou sensoriels et présente une réponse adéquate aux ordres verbaux, simples et complexes.
- Obnubilation : répond à des commandes verbales simples et à des stimuli douloureux, mais il n'y a pas de réponse adéquate à des commandes verbales complexes.
- Stupeur : se réveille seulement avec des stimuli très intenses et persistants et les réponses verbales sont lentes ou nulles; le patient fait des efforts pour éviter les stimuli douloureux.
- Coma : représente le degré maximum d'altération du niveau de conscience et peut varier du niveau de gravité au niveau superficiel (il n'y a qu'une réponse aux stimuli profonds douloureux lors du mouvement des extrémités) au niveau profond (il n'y a pas de réponse aux stimuli douloureux ou à la présence de tout type de réflexion).
- Mort cérébrale : perte irréversible de toutes les fonctions cérébrales et incapacité à maintenir une respiration autonome.
État de coma
Le terme coma est utilisé pour définir un état de diminution du niveau de conscience caractérisé par l'absence de réponses aux stimuli externes.
Normalement, l'individu apparaît dans un état les yeux fermés, sans signe de comportement volontaire ni de réponse aux ordres ou de type de stimulation (León-Carrión, Domínguez-roldan et Domínguez-morales, 2001).
Les causes
Le coma, de par sa définition, a pour origine un dysfonctionnement structurel ou fonctionnel (métabolique) du système réticulaire activant ascendant, mais il peut aussi être la conséquence de lésions cortico-sous-corticales diffuses (De Castro, 2008).
Par conséquent, dans l'étiologie du coma peut être distingué de nombreuses modifications qui mèneront à la souffrance de ceci:
Parmi les lésions structurelles, on trouve les hémorragies cérébrales, l'infarctus cérébral, les hématomes sous-duraux et épiduraux, les tumeurs cérébrales, les processus infectieux et démyélinisants (Puerto-Gala et autres, 2012).
Par ailleurs, des altérations métaboliques toxiques peuvent également se produire: intoxications endogènes (insuffisance hépatique, rénale, surrénalienne, hypercapnie, pancréatite, hyperglycémie ou hyperrosmolaire).
- Intoxications exogènes (sédatifs, barbituriques, amphétamines, alcool, inhibiteurs de la MAO, antiépileptiques, opioïdes, cocaïne, méthanol, éthylène glycol, neuroleptiques, etc.).
- Déficit métabolique (bronconeumopatías, intoxication par le CO, choc, maladies cardiovasculaires, Wernicke, déficit en vitamines B6 et B12 et acide folique).
- Altérations hydro-électrolytiques et équilibre acide-base).
- Troubles de la température.
- Épilepsie (Puerto-Gala et al., 2012).
Ainsi, ces facteurs provoqueront une situation comateuse lorsqu'ils toucheront de grandes zones du diencépon et du tronc cérébral et / ou des hémisphères cérébraux. Il est prouvé que les causes les plus fréquentes de coma sont les suivantes: lésions axonales diffuses, hypoxie et lésions secondaires affectant le tronc cérébral (León-Carrión, Domínguez-roldan et Domínguez-morales, 2001).
Évaluation du coma
Lorsqu'une personne est présentée à l'urgence d'un hôpital avec une absence totale de réponses et sans en avoir pleinement conscience, avant de déterminer le degré d'implication et le type de conscience altérée dont elle souffre, il est essentiel de contrôler les conditions physiques pouvant présenter un risque. vital pour la vie de la personne (De Castro, 2008).
Face à une situation d'absence de conscience, la collecte d'informations auprès de personnes proches de la personne touchée sera essentielle: informations sur les maladies associées, lésions cérébrales traumatiques antérieures, évolution temporaire de l'altération de la conscience, manifestations et lieux initiaux, consommation de drogue, expositions toxiques, etc. (Puerto-Gala et al., 2012).
De plus, un examen général des variables physiques individuelles sera effectué: pression artérielle (PA), rythme et fréquence cardiaque (HR) et respiratoire, température, glycémie, palpitations du cou et du crâne et signes méningés (Puerto-Gala et al., 2012). ).
Une fois que les affections nécessitant un traitement immédiat ont été écartées et que les pathologies présentant un risque vital pour le patient ont été contrôlées, une évaluation neurologique est effectuée (De Castro, 2008). L'évaluation neurologique explorera: le niveau de conscience, le schéma respiratoire, les réflexes tronc-cerveau, les mouvements des yeux et les réponses motrices (Puerto-Gala et al., 2012).
Parmi les instruments utilisés pour évaluer la profondeur des états de coma, l’échelle de Glasgow (GCS) est l’instrument le plus accepté pour ce type d’évaluation (León-Carrión, Domínguez-roldan, & Domínguez-morals, 2001).
Cette échelle utilise trois catégories d'évaluation: ouverture oculaire (spontané, ordre verbal, douleur, aucune réponse), meilleure réponse motrice (obéit à des ordres verbaux, localise la douleur, retrait, flexion d'ancrage, extension couchée et aucune réponse). et meilleure réponse verbale (réponse dirigée, réponse désorientée, mots inappropriés, sons incompréhensibles, aucune réponse). Par conséquent, le score qu'un individu peut obtenir sur une échelle va de 3 à 15 points (León-Carrión, Domínguez-roldan et Domínguez-morales, 2001).
Obtenir un score faible sur le SCG sera révélateur de la profondeur du coma. Un score inférieur de 9 indique des lésions cérébrales graves; un score entre 3 et 5 est révélateur de lésions cérébrales très profondes et de l'existence d'un coma profond (León-Carrión, Domínguez-roldan et Domínguez-morales, 2001).
Prévision et traitement
Lorsque la personne se trouve en unité de soins intensifs, la priorité est la survie. Le traitement médical dans la phase aiguë inclura la stabilisation du patient, le contrôle des problèmes médicaux préexistants et causés par la situation, la prévention des complications. Généralement, des traitements pharmacologiques et chirurgicaux sont utilisés.
Le pronostic de l'évolution et de la récupération des patients dans le coma est variable. Dans de nombreux cas, leur survie est menacée par différentes complications à la fois dans la phase aiguë (processus infectieux, troubles métaboliques, besoin de sonars et de cathéters, etc.) et dans la phase subaiguë (crises épileptiques, immobilisation, etc.) (Suite). Sesé et al., 2015).
Les interventions infirmières sont fondamentales pour la prévention des infections et des complications, la gestion de l'incontinence et la nutrition (Más-Sesé et al., 2015).
Dans la phase subaiguë, lorsque l'individu ne sort pas du coma, une intervention neurologique et neuropsychologique intensive sera réalisée. Les actions viseront à obtenir une urgence allant d'un état de conscience altéré à un état supérieur, grâce à l'utilisation d'une stimulation multisensorielle qui agit sur trois domaines: somatique, vibratoire et vestibulaire, en essayant d'améliorer la capacité de perception du patient (Más-Sesé et al. al., 2015).
De plus, la participation d'un spécialiste en physiothérapeute sera essentielle pour le contrôle de l'atrophie musculaire. La physiothérapie intervient principalement dans le contrôle postural et le maintien du tonus musculaire et du système ostéoarticulaire (Más-Sesé et al., 2015).
Si le patient parvient à sortir du coma, il est probable qu'il présentera des déficits neurocognitifs, comportementaux, affectifs et sociaux significatifs. Tout cela nécessitera une intervention spécialisée (León-Carrión, Domínguez-roldan et Domínguez-morales, 2001).
Conclusions
En cas de lésions cérébrales graves impliquant un processus de perte de conscience, des soins médicaux urgents et spécialisés sont indispensables pour contrôler la survie et les complications futures.
La situation dans le coma est une condition très limitante non seulement pour l'individu mais également pour ses proches. Dans la plupart des cas, la famille devra recevoir un soutien, des conseils ou même une psychothérapie pour faire face à la situation (Más-Sesé et al., 2015).
Que le patient évolue favorablement ou que l'état de coma persiste, entraînant la persistance d'un état persistant, il sera essentiel que la famille travaille de manière coordonnée et organisée avec les équipes médicales et de rééducation.