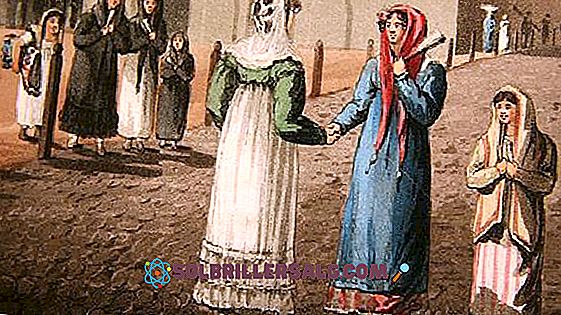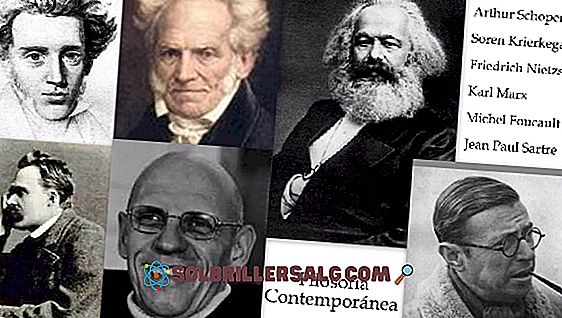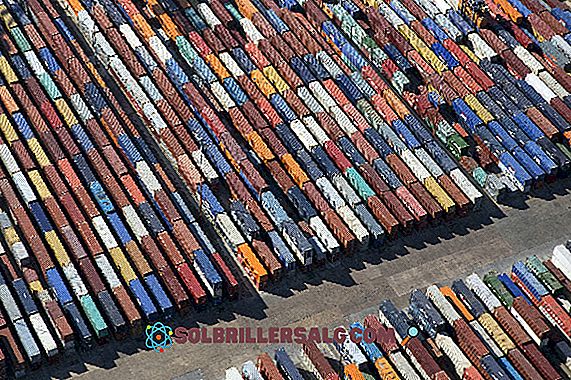La coprecipitation: en quoi consiste-t-elle, types et applications
La coprécipitation est la contamination d'une substance insoluble qui transporte les solutés dissous du milieu liquide. Ici, le mot "contamination" s'applique aux cas où les solutés solubles précipités par un support insoluble sont indésirables; mais lorsqu'ils ne le sont pas, une autre méthode analytique ou synthétique est à portée de main.
Par contre, le support insoluble est la substance précipitée. Cela peut transporter le soluté soluble à l'intérieur (absorption) ou à sa surface (adsorption). Cela changera complètement les propriétés physicochimiques du solide obtenu.

Bien que le concept de coprécipitation puisse sembler un peu déroutant, il est plus courant que vous ne le pensez. Parce que? Parce que, plus que de simples solides contaminés, des solutions solides de structures complexes se forment et sont riches en composants précieux. Le sol à partir duquel les plantes sont nourries sont des exemples de coprécipitation.
De même, les minéraux, les céramiques, les argiles et les impuretés dans la glace sont également un produit de ce phénomène. Sinon, les sols perdraient une grande partie de leurs éléments essentiels, les minéraux ne seraient pas tels qu'ils sont connus aujourd'hui et il n'y aurait pas de méthode importante pour la synthèse de nouveaux matériaux.
Qu'est-ce que la coprécipitation?
Pour mieux comprendre l'idée de coprécipitation, l'exemple suivant est proposé.
Au-dessus (image du haut), vous avez deux récipients contenant de l'eau, dont l'un contient du NaCl dissous. NaCl est un sel très soluble dans l'eau, mais la taille des points blancs est exagérée à des fins explicatives. Chaque point blanc deviendra de petits agrégats de NaCl dans une solution au bord de la saturation.
En ajoutant aux deux récipients un mélange de sulfure de sodium, Na 2 S et de nitrate d'argent, AgNO 3, précipitera un solide noir insoluble de sulfure d'argent, AgS:
Na 2 S + AgNO 3 => AgS + NaNO 3
Comme on peut le voir dans le premier récipient avec de l’eau, un solide noir précipite (sphère noire). Cependant, ce solide dans le conteneur contenant du NaCl dissous contient des particules de ce sel (sphère noire avec des points blancs). Le NaCl est soluble dans l’eau, mais lors de la précipitation de l’AgS, il est adsorbé sur la surface noire.
On dit alors que NaCl a coprécipité sur AgS. Si le solide noir était analysé, des microcristaux de NaCl pourraient être observés à la surface.
Cependant, ces cristaux pourraient également être à l'intérieur de l'AgS, de sorte que le solide deviendrait grisâtre (blanc + noir = gris).
Types
La sphère noire avec des points blancs et la sphère grise montrent qu'un soluté soluble peut coprécipiter de différentes manières.
Dans le premier, il le fait superficiellement, adsorbé sur le support insoluble (AgS dans l'exemple précédent); alors que dans le second cas, il modifie de manière interne le noir du précipité.
Pouvez-vous obtenir d'autres types de solides? C'est-à-dire une sphère avec des phases noires et blanches, c'est-à-dire AgS et NaCl (avec NaNO 3 qui co-précipite également). C'est là que naît l'ingéniosité de la synthèse de nouveaux solides et matériaux.
Cependant, pour revenir au point initial, le soluté soluble coprécipite en générant différents types de solides. Ensuite, nous mentionnerons les types de coprécipitation et les solides qui en résultent.
L'inclusion
On parle d'inclusion lorsque, dans le réseau cristallin, l'un des ions peut être remplacé par une partie de la substance soluble coprécipitée.
Par exemple, si NaCl avait coprécipité par inclusion, les ions Na + auraient pris la place de Ag + dans une section de l'arrangement cristallin.
Cependant, de tous les types de coprécipitation, c'est le moins probable; puisque, pour que cela se produise, les rayons ioniques doivent être très similaires. Revenant à la sphère grise de l'image, l'inclusion en viendrait à être représentée par une des nuances grisâtres plus claires.
Comme on vient de le mentionner, l'inclusion se produit dans les solides cristallins, et pour les obtenir, il faut maîtriser la chimie des solutions et plusieurs facteurs (T, pH, temps d'agitation, rapports molaires, etc.).
Occlusion
Dans l'occlusion, les ions sont piégés dans le réseau cristallin mais sans remplacer aucun ion de la matrice. Par exemple, des cristaux de NaCl occlus peuvent se former dans l’AgS. Graphiquement, il pourrait être visualisé comme un cristal blanc entouré de cristaux noirs.
Ce type de coprécipitation est l’un des plus courants et, grâce à lui, il existe une synthèse de nouveaux solides cristallins. Les particules occluses ne peuvent pas être enlevées avec de simples lavages. Pour cela, il faudrait recristalliser le tout, c'est-à-dire le support insoluble.
L'inclusion et l'occlusion sont des processus d'absorption donnés dans les structures cristallines.
L'adsorption
Lors de l'adsorption, le solide coprécipité se trouve à la surface du support insoluble. La taille des particules de ce support définit le type de solide obtenu.
S'ils sont petits, on obtiendra un solide coagulé à partir duquel il sera facile d'éliminer les impuretés; mais s'ils sont très petits, le solide absorbera des quantités abondantes d'eau et sera gélatineux.
De retour à la sphère noire avec des points blancs, les cristaux de NaCl coprécipités sur l’AgS peuvent être lavés à l’eau distillée. Donc, jusqu'à ce que l'AgS soit purifié, ce qui peut ensuite être chauffé pour évaporer toute l'eau.
Les applications
Quelles sont les applications de la coprécipitation? Certains d'entre eux sont les suivants:
-Il permet de quantifier les substances solubles qui ne sont pas facilement précipitées du milieu. Ainsi, à travers un support insoluble, il nécessite par exemple des isotopes radioactifs, tels que le francium, pour étude et analyse ultérieures.
- Lors de la coprécipitation des ions dans les solides gélatineux, le milieu liquide est en cours de purification. L'occlusion est encore plus souhaitée dans ces cas, car l'impureté ne peut pas s'échapper vers l'extérieur.
-La coprécipitation permet l'incorporation de substances dans les solides lors de leur formation. Si le solide est un polymère, il absorbera alors des solutés solubles qui vont ensuite coprécipiter à l'intérieur pour lui donner de nouvelles propriétés. S'il s'agit de cellulose, par exemple, vous pourriez le faire coprécipiter avec du cobalt (ou un autre métal) à l'intérieur.
En plus de tout ce qui précède, la coprécipitation est l’une des méthodes clés pour la synthèse de nanoparticules sur un support insoluble. Grâce à cela, des bionanomatériaux et des nanoparticules de magnétite ont été synthétisés, entre autres.